La Mission Interrégionale Inondation Arc-Méditerranéen (MIIAM) fait le bilan des actions 2020 et présente les perspectives 2021.
Découvrez les actions conduites et programmées grâce à ces deux plaquettes.
La Mission Interrégionale Inondation Arc-Méditerranéen (MIIAM) fait le bilan des actions 2020 et présente les perspectives 2021.
Découvrez les actions conduites et programmées grâce à ces deux plaquettes.
Dans le cadre des travaux du groupe « PTGE » mis en place suite aux Assises de l’eau, le ministère a engagé 2 démarches « d’accompagnement » des projets territoriaux :
L’ANEB a proposé que le travail d’analyse associe le plus possible les structure porteuses « collectivités ». La consultation sur les situations territoriales (freins et leviers) est en cours (janvier 2021).
Dernière réunion : le 11 décembre 2020
Voir diaporama en PJ*
Points abordés :
Articulation entre PTGE et AUP
Dimensionnement financier des études à conduire dans le cadre de projets de territoire : études volumes prélevables , études d’impact, études socio économiques
Dispositions relatives à la gestion quantitative dans les futurs SDAGE 2022 2027
Réunion du 5 novembre 2020
Voir diaporama en PJ*
Points abordés : poursuite des échanges sur les modalités de détermination des volumes prélevables et AUP au regard de la préparation des textes (décret et arrêté). Enjeux sur la précision des termes employés et sur l’évaluation des volumes, des usages, de l’échelle territoriale de détermination, des acteurs associés etc.
Présentation d’une liste de projets rencontrent des difficultés de mise en œuvre (contentieux).
Présentation de la note de prospective réalisée par le secrétariat technique du SDAGE Rhône Méditerranée « Anticiper le changement climatique pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ; prospective appliquée au PGRE et autres PTGE ».
Réunion du 25 septembre 2020
Points abordés : projet de décret gestion quantitative : travail jusqu’en novembre 2020. Objectif de clarification sur les AUP, de définition des modalités de détermination des Volumes Prélevables.
Présentation de deux exemples de projets mis en œuvre sur les territoires de la Sèvre Niortaise et de la nappe de l’Est lyonnais.
Présentation d’une fiche de présentation type de PTGE.
Réunion du 9 juillet 2020
Points abordés : les difficultés rencontrées dans le cadre des AUP, la question de la détermination des volumes prélevables et les questions de dimensionnement des besoins en eau / sobriété des usages de l’eau.
Voir les documents joints : diaporama du 9 juillet + éléments méthodo détermination des volumes prélevables dans les eaux souterraines
Réunion du 12 juin 2020
Points abordés : Présentation d’un état d’avancement des PTGE et les points d’attention, le mandat et attendus du GT et les évolutions réglementaires possibles.
*Merci de ne pas diffuser les documents présentés annexés à cet article.

À l’instar des autres types de zones humides, les mares sont victimes d’une régression régulière. Leur discrétion, leur répartition souvent diffuse et l’absence quasi générale de mesures de protection, les rend particulièrement vulnérables.
Sur le territoire du Parc naturel régional du Luberon, 60% des zones humides inventoriées sont des mares. La plupart sont d’origine humaine liée principalement aux activités passées d’exploitation des ocres et à l’irrigation agricole.
Les mares constituent des biotopes originaux au sein des zones sèches du Luberon. Elles abritent une biodiversité importante, en particulier concernant le groupe des amphibiens qui est riche de 9 espèces différentes. Ces amphibiens sont tous très utiles car ils font office d’insecticide naturel pour les agriculteurs et les jardiniers puisqu’ils se nourrissent d’insectes et d’invertébrés (limaces, escargots…).
Toutes les informations sur le site du Parc Naturel Régional du Lubéron

Depuis trente ans, les études, les rapports, portant sur la question de l’eau, sur sa disponibilité et sa qualité, que ce soit en France ou à l’échelle internationale, parviennent tous à la même conclusion : « Les ressources en eau, en particulier l’eau douce vont devenir l’une des ressources les plus rares pour les humains et les sociétés ».
Pour aborder tous les enjeux que ces constats couvrent (accès à l’eau, disponibilité et qualité de la ressource, articulation des différents cadres juridiques européens…), EUROPA, organisation non gouvernementale, a organisé ce colloque en webinaire, structuré autour de différents temps :
Pour plus d’informations sur le webinaire, rendez-vous sur : https://www.europaong.org/

Le 28 Septembre 2020 s’est tenu un atelier de réflexion en ligne sur les stratégies locales, régionales et nationales de restauration des tourbières en France, organisé par l’Université d’Orléans, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et le Centre National de La Recherche Scientifique (CNRS).
Catherine Gremillet, Directrice de l’ANEB, est intervenue durant la matinée sur l’articulation des actions locales, l’échelle bassin, et nationale.
Découvrez l’intervention en vidéo ou consultez son résumé en page 8 du rapport ci-joint sur les webinaires :
Sessions animées par Francis Muller, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels / Pôle-relais tourbières


Pour accédez à l’ensemble des vidéos et aux documents présentés, cliquez-ici.
Vous pouvez aussi consulter et télécharger gratuitement la « Synthèse et principales leçons de l’appel à partenaires« .

La réunion de la Commission d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH) du Comité National de l’Eau (CNE) à laquelle a participé l’ANEB s’est tenue le 16 novembre dernier.
A cette occasion, un bilan de la sécheresse 2020 et des travaux engagés pour renforcer le dispositif de gestion de crise en période de sécheresse ont été présentés. Le diaporama de la réunion figure en fichier joint.
Une réunion de concertation technique avec les parties prenantes et représentants des élus et des usagers concernant la finalisation des travaux sur le guide sécheresse est prévue le 8 décembre, afin notamment d’échanger sur les mesures générales de restriction et les règles particulières et dérogations individuelles.
Merci de ne pas diffuser les documents transmis et annexés à cet article.

Espaces de forts enjeux écologiques, économiques et sociaux, les zones humides représentent de sérieux atouts pour les territoires qui les abritent. Pourtant, leur présence est encore souvent perçue comme une contrainte dans le cadre des projets d’aménagement et d’urbanisation. Cela s’explique souvent par des manques de connaissances sur leur localisation, leur fonctionnement, l’articulation des enjeux à des échelles différentes.
Face à ce constat, le programme Territoires Engagés pour la Nature (TEN) apparaît comme une opportunité pour les collectivités d’intégrer de façon durable des milieux précieux et vulnérables à l’aménagement de leur territoire. Ce dispositif d’ingénierie territoriale est destiné à faire émerger, reconnaitre et accompagner les collectivités dans cet engagement de leur territoire en faveur de la biodiversité.
Si TEN reconnait et accompagne l’engagement pour l’avenir des communes et intercommunalités en faveur de la biodiversité, la démarche est complétée par le concours Capitale française de la Biodiversité qui valorise quant à lui leurs actions exemplaires d’ores et déjà mises en place.
Le lien entre Biodiversité et Zones humides sera encore plus prégnant cette année puisque le thème du concours porte sur « Biodiversité et Eau ».
Cette Master Classe est l’occasion de découvrir ces démarches et d’échanger avec les élus ayant fait le choix d’engager leur collectivité en faveur de la biodiversité, en s’y appuyant. Pourquoi s’engager dans une telle démarche ? Quels bénéfices pour son territoire ? Est-il fait le choix d’associer les habitants et acteurs socio-économiques à la démarche ? quelle communication ?…

Les intervenants ont tenu à rappeler différents points essentiels concernant le dispositif TEN. Avant tout, il s’agit d’un dispositif d’accompagnement. S’il n’existe pas de budget propre au dispositif TEN, l’accompagnement des collectivités engagées, vise bien à guider et flécher la collectivité vers les aides et outils financiers existants spécifiquement sur le territoire.
TEN doit être perçu comme une dynamique permettant de mettre en synergie les acteurs du territoire (syndicat de rivière, collectivités, associations, agriculteurs…) et de s’appuyer sur leurs expertises et compétences techniques pour mener à bien les actions de préservation de la biodiversité.
Ils sont également revenus sur la nécessité d’une bonne connaissance de l’emplacement des ZH, d’où l’importance des inventaires pour les inscrire dans les PLU et pouvoir proposer aux aménageurs, des zones sans enjeux environnementaux majeurs…
Patrick Barbier, maire de Muttersholtz, petite commune de 2000 habitants, entièrement située sur une zone humide, a parfaitement illustré l’importance de l’éducation, de la sensibilisation sur le long terme et du travail avec les associations, les enseignants et autres relais sur le territoire.
Pour cet élu engagé pour la nature, « la reconnaissance TEN apporte un surcroit de fierté pour ses habitants et donc une mobilisation supplémentaire »

Introduction de l’ANEB
–> vidéo et présentation
Présentation du programme TEN – Mathilde MAISANO – Chargée de mission « Territoires Engagés pour la Nature» – OFB
–> vidéo et présentation
Panorama des actions en faveur des Zones Humides des Capitales Françaises pour la Biodiversité – Gilles LECUIR – Chargé d’études – ARB Ile de France :
–> vidéo et présentation
Questions / Réponses partie 1 : vidéo
Animation territoriale de TEN et accompagnement des actions en faveur des Zones Humides Benjamin VIRELY – Chargé de mission Animation territoriale biodiversité – ARB Centre Val de Loire et Pascale LARMANDE – Animatrice territoriale « Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature » – Projet life intégré – ARB Centre Val de Loire :
–> vidéo et présentation
Questions / Réponses partie 2 : vidéo
Saint-Jean de Braye (45) (vidéo enregistrée), commune du Centre Val de Loire, reconnue Territoire Engagé pour la Nature – Franck FRADIN, adjoint délégué à l’agriculture et au patrimoine naturel et bâti – Saint-Jean de Braye (45) :
–> vidéo
Témoignage d’une commune reconnue Capitale Française pour la Biodiversité et Territoire Engagé pour la Nature – Patrick BARBIER – Maire de Muttersholtz :
–> vidéo et présentation
Discussion avec la « salle » : vidéo
Cette Master Classe s’inscrit dans les dynamiques nationales animées par l’ANEB-PRMVA pour favoriser le rapprochement des acteurs de l’eau, de la biodiversité, de l’aménagement et de l’urbanisme»




Les consulter et les télécharger

Le 1er décembre 2020 9h30-12h00 ; 13h30-15h00
L’objectif de cette journée est de présenter des outils et retours d’expériences qui concilient gestion de l’eau, des milieux aquatiques et l’aménagement du territoire, à travers le témoignage de divers acteurs : gestionnaires de milieux aquatiques et collectivités, bureau d’étude, associations et organismes institutionnels.
La matinée sera construite autour d’interventions sur l’intégration de l’enjeu eau dans les documents de planification, l’après-midi présentera des outils de maîtrise foncière et un projet d’aménagement de cours d’eau en milieu urbain.
Public : gestionnaires de milieux aquatiques, collectivités et institutions de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Présentation du SYMBH : Aménagement GEMA, PI et de valorisation de l’Huveaune dans le secteur amont du Pont Heckel à Marseille disponible ici
Date : le 3 décembre 2021
Heure : de 11h à 11h45
Inscription : gratuite sur inscription en activant ce lien
« Le plan France relance doté de 100 milliards d’euros se prépare dans une France reconfinée et sans garantie de soutien pérenne pour les collectivités qui craignent de voir leur autofinancement rongé par la crise sanitaire. Pourtant en suivant quelques règles de gestion interne et en sachant aller chercher les subventions, ce plan peut être une opportunité pour votre collectivité. Décryptage, explications, conseils à suivre lors du prochain webinaire du Club Finances. «

Nature en ville, Zéro Artificialisation Nette, Solutions fondées sur la nature, Eviter-Réduire- Compenser… : autant de concepts et outils vertueux qui ont pour objectif de renaturer nos villes, lutter contre l’imperméabilisation et les conséquences du changement climatique.
Cette Master Classe propose d’interroger les acteurs de l’eau, de l’urbanisme et de l’aménagement sur les opportunités qu’ils représentent pour la préservation et la valorisation des zones humides.
Comment ces concepts sont-ils perçus et mis en œuvre par les différents acteurs de la planification et de l’aménagement opérationnel ? Quels sont les besoins et les attentes des aménageurs pour mieux prendre en compte ces milieux dans leurs projets d’aménagement ? Comment articuler concepts et documents de planification ? Comment mieux faire s’accorder les enjeux « urbanisation » et protection des zones humides ? …
– Présentation et vidéo
– Présentation et vidéo
– Présentation et vidéo
– Présentation et vidéo
– Présentation et vidéo
– Vidéo de la partie discussion

Retrouvez tous les contenus ici
Cette Master Classe s’inscrit dans les dynamiques nationales animées par l’ANEB-PRMVA pour favoriser le rapprochement des acteurs de l’eau, de la biodiversité, de l’aménagement et de l’urbanisme»




Certaines dépenses des collectivités et groupements de collectivités oeuvrant dans le domaine de la gestion globale de l’eau sont susceptibles d’être éligibles au FCTVA (fonds de compensation de la TVA). Par ailleurs, l’État a engagé une réforme comptable devant conduire à l’automatisation du FCTVA jusqu’alors soumis à déclaration de la part des collectivités. Connaître ce nouveau mécanisme en cours de déploiement permettra d’optimiser au mieux les dotations au titre du FCTVA.
Avec les interventions de :
Avec les interventions de :
Cabinet FIDAL

Partenaires Finances Locales

Est paru le décret du 13 novembre 2020 portant nomination de sous-préfets chargés de mission dans le cadre de la déclinaison territoriale du plan de relance. A retrouver ci-joint.
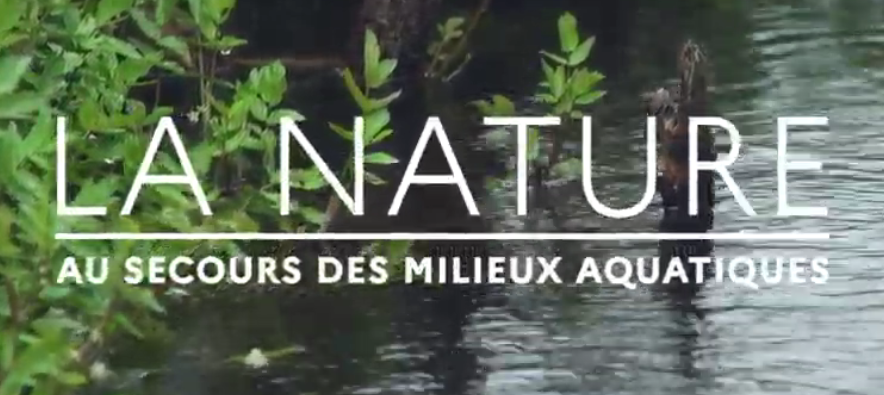
Depuis quelques années plusieurs régions françaises ont fait le pari de croire au génie écologique et aux solutions fondées sur la nature.
Les Zones Humides, qu’elles soient situées en bord de mer, en montagne ou en zone urbaine, occupent une place prépondérantes dans l’équilibre de notre environnement et encore davantage face aux défis du Changement Climatique.
Dans la collection : Développement durable : s’engager et agir, les Ministères de la Transition Ecologique, de la Cohésion des Territoires et de la Mer présentent au travers ce cette vidéo, 3 exemples de mise en œuvre des solutions fondées sur la nature (SfN) :

Au sein de ce numéro, l’ANEB et son réseau proposent un éclairage sur le thème de la gestion de crise et les enjeux auxquels elle touche en terme de gouvernance, d’organisation, d’outils et de communication.

La situation sanitaire amène à repenser les temps de rencontre par :
L’organisation de webinaires internationaux en juin 2021, centrés sur les thématiques de l’appel à communication I.S.Rivers. Une belle occasion de découvrir, au travers de quelques communications, l’esprit des conférences I.S.Rivers.
Le report de la conférence I.S.Rivers à juin 2022, pour pouvoir envisager l’évènement en présentiel, pour qu’I.S.Rivers reste un lieu de rencontres et d’échanges pour la communauté de scientifiques et praticiens. .
L’appel à communication d’I.S.Rivers 2022 sera lancé en juin 2021.
Plus d’information : https://www.graie.org/ISRivers/

L’ANEB est association partenaire de l’événement.



Cette webconférence invite les participants à échanger avec des élu.e.s qui ont fait des zones humides un atout majeur de leur territoire. En effet, les milieux humides sont des « infrastructures naturelles » incontournables pour la prévention des risques naturels (inondations, sécheresses, submersions marines), la préservation de la ressource en eau ou encore l’amélioration du cadre de vie.
Élu.e.s muncipaux et intercommunaux, vous avez la possibilité d’être moteurs pour améliorer la résilience de votre territoire !
*Madame Frédérique Tuffnell est notamment co-rédactrice du rapport parlementaire « Terres d’eau, terres d’avenir » (janvier 2019), ainsi que d’une tribune appelant en avril 2020 à une reprise économique prenant en compte climat et biodiversité. En septembre 2020, elle a déposé un amendement adopté visant la préservation des critères de reconnaissance des zones humides.
Animation : Maxime Fouillet, Office international de l’eau
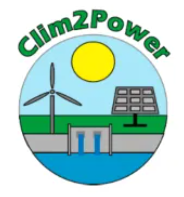
Dans le cadre du projet Clim2Power est organisé un atelier virtuel sur «Gestion de la ressource en eau et production hydroélectrique sous changement climatique: quels enjeux et solutions?». Il a eu lieu le 24 novembre 2020 (format virtuel, 10h-16h).
Clim2Power est un projet de recherche qui crée un pont entre des connaissances scientifiques complexes basées sur des modèles et des informations ciblées et utilisables pour les utilisateurs finaux. Il est porté par ACTeon et CMA MINES ParisTech.
Consulter la plaquette de présentation de l’atelier ci-contre.
Retrouvez les contenus de cet atelier virtuel ci-dessous :

Cette journée sera consacrée aux passes intertidales temporaires des lagunes corses.
Découvrez la plateforme Recherche-Gestion
Dans un souci d’organisation, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire à l’évènement via le lien ci-dessous, avant 12 Octobre 2020 au plus tard.
Le programme ainsi que le lieu de la rencontre vous seront très prochainement communiqués.
Le programme prévisionnel actuel prévoit une journée en 2 temps : (i) la matinée sera consacrée à des présentations relatives aux apports scientifiques et aux retours d’expériences de gestionnaires et (ii) l’après-midi une table ronde animée par différents spécialistesseral’occasion d’aborder des questions plus techniques (e.g. artificialisation des graus, coût, matériaux, études sédimentologiques et hydrologiques, récifs artificiels) afin de pouvoir apporter des réponses ou des pistes de réponses à des problématiques spécifiques posées par les gestionnaires de la région Corse.
Afin que cette table ronde puisse remplir ses objectifs, les animateurs auraient besoin d’avoir en amont vos problématiques dans le but de pouvoir les étudier. Surtout n’hésitez pas à me faire remonter le plus tôt possible vos besoins
L’ANEB participe au groupe de pilotage des informations géographiques sur l’eau, piloté par l’OFB.
Vous trouverez en PJ le compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2020.
Pour retrouver toutes les réunions du GPIGe, cliquez-ici
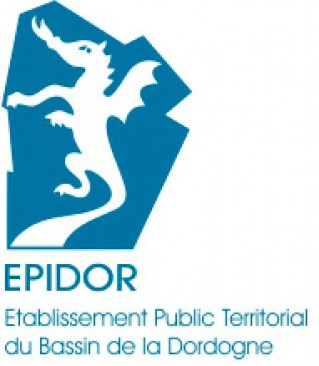
L’EPIDOR, EPTB de la Dordogne organisait un colloque sur les cyanobactéries le jeudi 19 novembre 2020.
« On observe une augmentation des restrictions d’usages baignade en plan d’eau liés aux cyanobactéries. Aussi, certains captages eau potable en eau de surface présentent des contaminations aux cyanobactéries. Il n’existe pas de solution « miracle ». L’analyse des données, issues des contrôles sanitaires baignade sur 88 plans d’eau du bassin versant Dordogne, montre une grande variabilité de situation. Certains plans d’eau n’ont jamais connu d’efflorescence, d’autres présentent des dépassements des seuils sanitaires récurrents. La corrélation avec la taille des plans d’eau, des bassins versants, leurs volumes, ou leur taux de renouvellement, n’est pas évidente. Il n’existe pas de logique de répartition géographique des différents genres. Face aux évolutions des connaissances scientifiques, des recommandations de gestion et des retours d’expérience toujours plus nombreux, EPIDOR dans son rôle d’appui technique aux collectivités, a décidé d’organiser cette conférence à destination des gestionnaires, des collectivités, des services déconcentrés de l’état et à tous les professionnels des milieux aquatiques. »
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre de participants en présentiel est limité. Toute personne non inscrite ne pourra pas accéder au colloque.
Une participation par visioconférence est proposée lors de l’inscription pour les personnes qui le souhaitent.
Les inscriptions au colloque sont ouvertes jusqu’au 9 novembre 2020 (inclus).