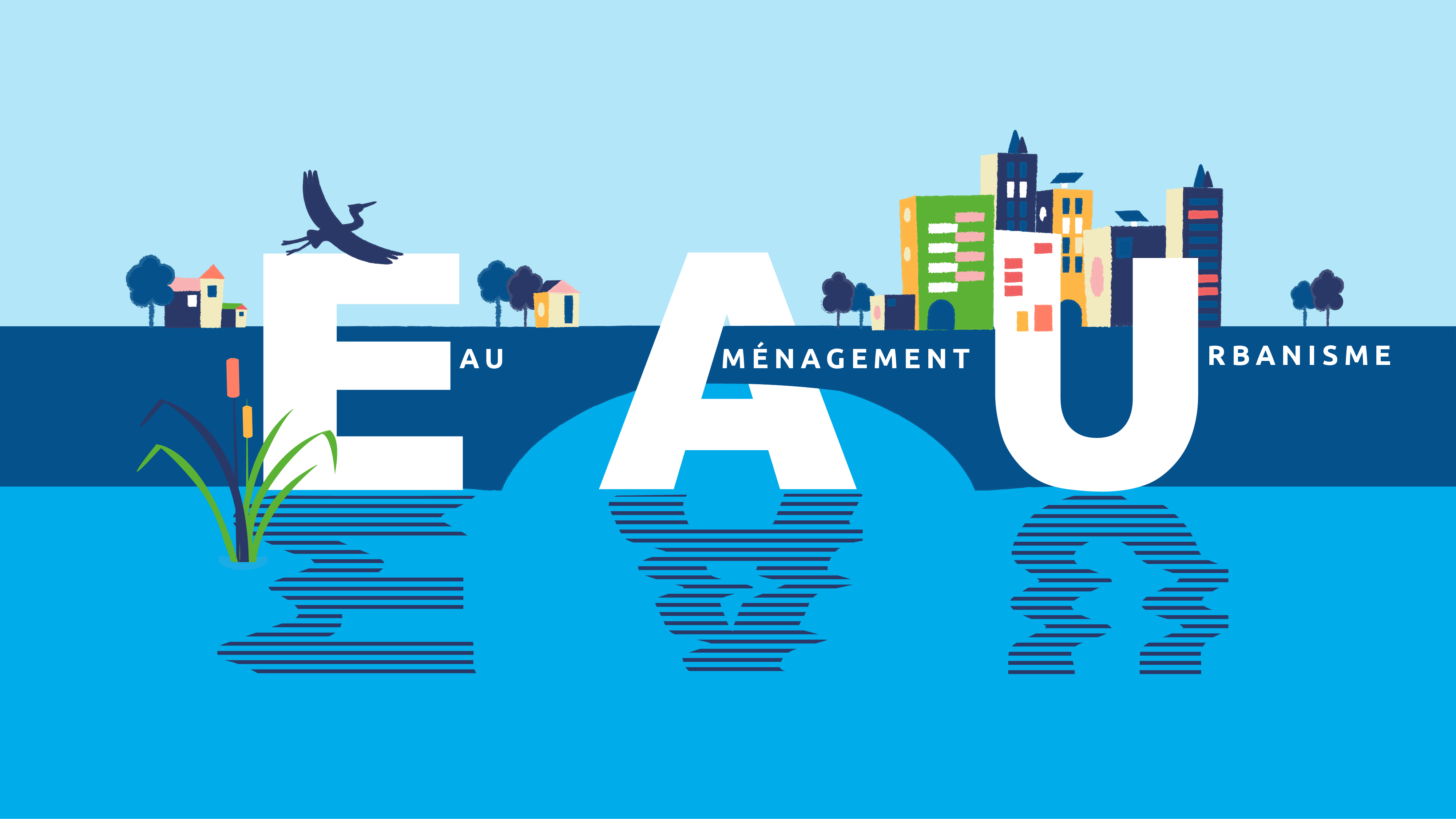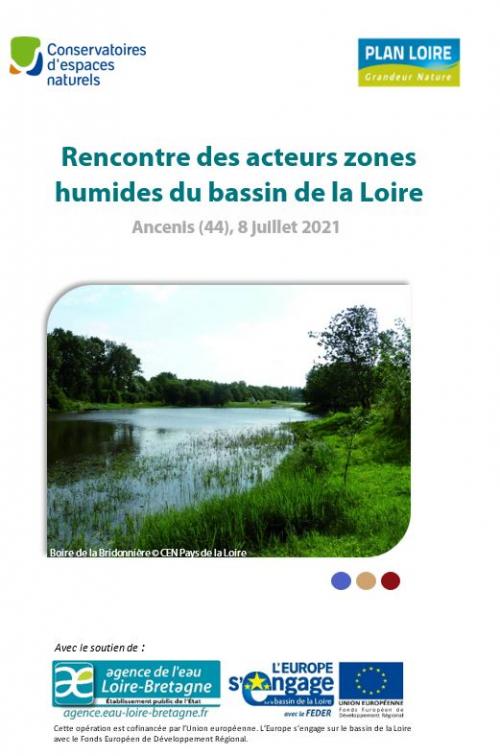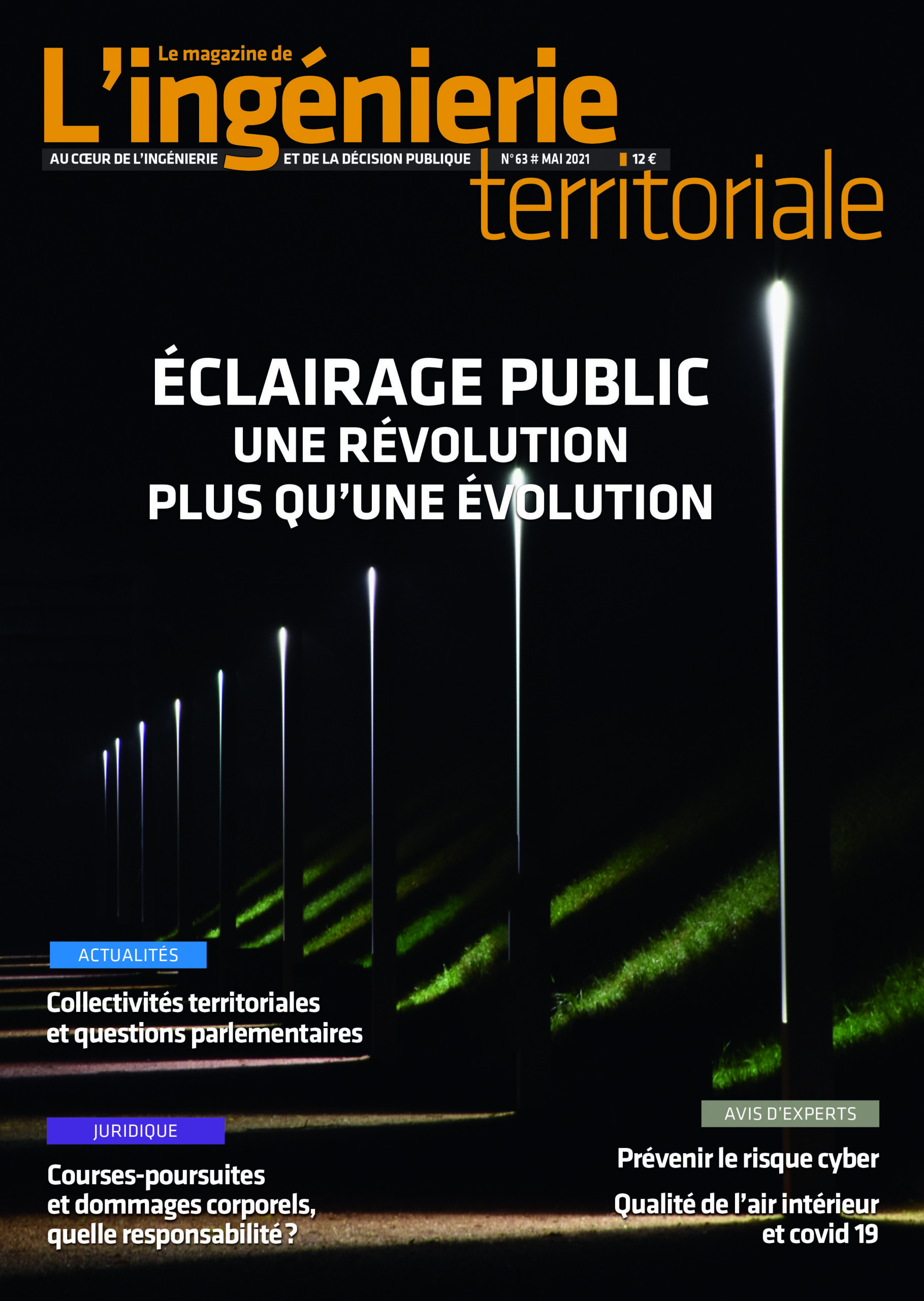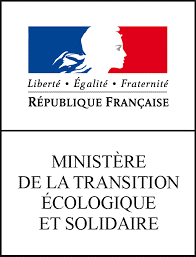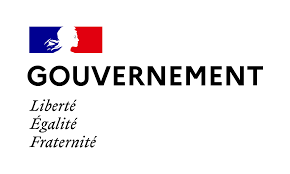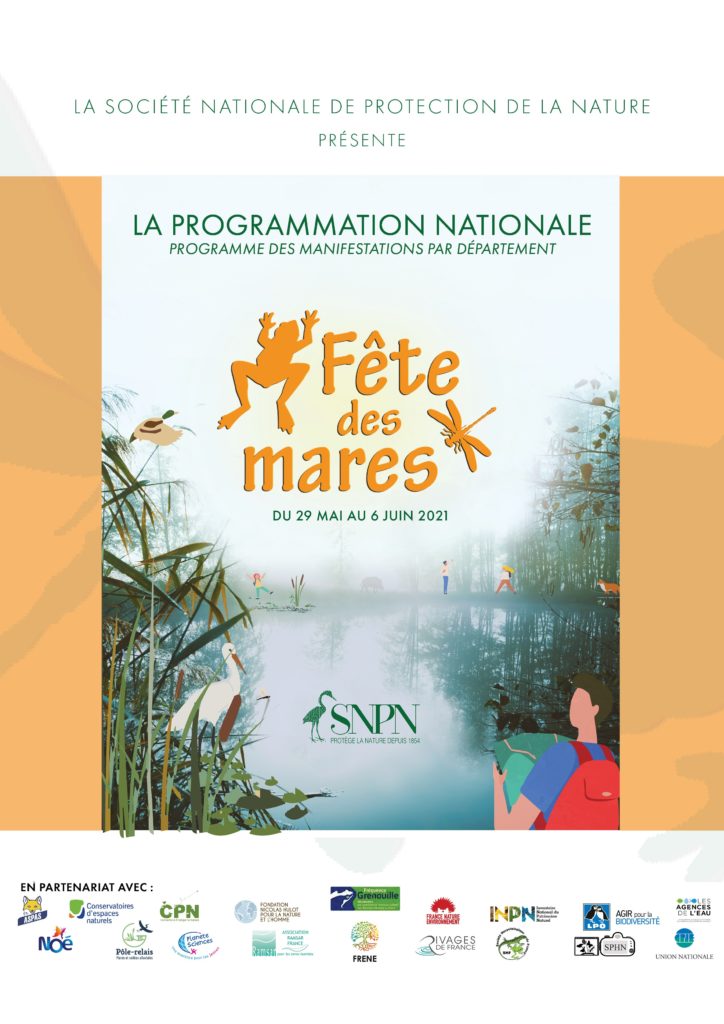Ce projet comporte plusieurs dispositions que nous saluons, comme la préservation et la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques ou encore l’intégration de mesures spécifiques pour la préservation des ressources en eau souterraines stratégiques, nous ne pouvons que regretter que la gestion de l’eau soit si peu appréhendée alors qu’elle est essentielle pour l’adaptation aux changements climatiques.
L’ANEB souhaite l’amendement de la proposition de modification de l’article L214-17 du code de l’environnement relatif à la continuité écologique, inscrite dans l’article 19 bis C, supprimant la possibilité d’araser certains barrages, car elle réduirait, telle qu’écrite, nos capacités d’atteinte des objectifs de bon état écologique, ce qui va à l’encontre de l’objectif du projet de loi.
Nous proposons, afin d’assurer une gestion intégrée de l’eau, que soit renforcée et déployée notre organisation par bassin sur tout le territoire national. Elle permet en effet de traduire de manière différenciée, adaptée aux spécificités territoriales, les objectifs de gestion de l’eau tout en prenant en compte les différents usages actuels et prospectifs. Cette organisation, déjà existante sur de nombreux territoires, permet de parvenir à des solutions partagées. Elle doit se développer et devenir une composante centrale de l’application de la règlementation.
Nous proposons également, pour éviter toute ambiguïté, de préciser dans la loi et dans le cadre des projets de territoires, que les solutions pour répondre aux objectifs de continuité écologique soit plurielles, et dépendantes des objectifs globaux de bassin et de la situation locale. Si des conflits persistent malgré la co-construction territoriale, la mise en place d’une procédure de médiation pourrait utilement compléter l’organisation en place par le biais d’un référent territorial qui ferait le lien entre propriétaires de moulins et administration, avec un renvoi à une commission nationale adossée au comité national de l’eau en cas de conflits persistants.
Concernant les articles relatifs à l’artificialisation des sols inscrit dans les articles 47, 48, 49 et 50, si nous partageons l’ambition fixée, il nous semble utile de territorialiser les objectifs généraux dans des stratégies de bassin. Les politiques d’urbanisme doivent également plus fortement associer les acteurs de l’eau dans la déclinaison des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols.
Mardi 2 juin 2021, la commission a adoptée l’article 19 bis C, intégrant l’amendement du rapporteur Pascal MARTIN (qui ne supprime pas la limitation des aménagements possibles pour certains ouvrages mais ouvre la possibilité pour les propriétaires le souhaitant, et ajute une procédure de conciliation), auquel s’ajoute un amendement identique de la commission porté par la sénatrice Laurence MULLER-BRONN, ainsi qu’un autre amendement de la sénatrice Nathalie DELATTRE, qui exonère les installations situées sur les cours d’eau de catégorie 2, et qui reprend l’article 5 de la proposition de loi sur l’hydroélectricité du sénateur Daniel GREMILLET, adopté au Sénat le 13 avril 2021.
Mercredi 3 juin 2021, les articles 48, 49 et 50 ont également été adoptés en commission. Ils ne prennent pas en compte l’intégration d’objectifs eau dans la territorialisation des objectifs d’artificialisation que nous appelions de nos voeux dans nos amendements.
Article 19 bis C « Moulins »
Jeudi 17 juin 2021, en séance publique, l’article 19 bis C a été adopté conforme, à la rédaction issue de l’Assemblée nationale (amendement rectifié bis du sénateur Guillaume Chevrollier).
Le vote de cet amendement a eu malheureusement pour effet de faire tomber les autres amendements notamment ceux qui nous étaient plus favorable. La sénatrice Martine Filleul a parlé dans son intervention en séance des actions et du travail de l’ANEB. Le sénateur Ronan Dantec a retiré son amendement, qui visait lui la suppression des dispositions étendant les dérogations de mise en œuvre de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, car il souhaitait finalement en rester au dispositif de la commission (amendement Martin). Issue malheureusement la plus défavorable ! Le petit point positif pourrait être la suppression de la modification du L218-14-1 … Le vote étant conforme sur l’article 19 bis C avec le vote à l’Assemblée nationale, il ne sera pas possible d’y revenir dans le cadre d’une éventuelle CMP (reste le conseil constitutionnel et éventuellement la cour de justice de l’Union Européenne).
Article 48 et 50 « Artificialisation des sols »
Vendredi 25 juin 2021, l’article 48 et 50 sur l’artificialisation des sols ont été voté avec notamment 3 amendements qui suppriment l’alinéa 10 de l’article 48, sur la précision relative aux surfaces de pleine terre (les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées).
Article 58 E et article 58 BAB « Trait de côte »
Samedi 26 juin 2021, l’article 58E sur le recul du trait de côte a été voté avec un amendement de précision rédactionnelle du Rapporteur Pascal Martin. Cet article créé donc un droit d’option pour les communes les plus exposées a l’érosion littorale. Le Gouvernement n’ayant pas réussi à revenir sur l’obligation de réaliser une cartographie locale des zones concernées par l’érosion côtière. L’article 58 BAB réajuste la définition du recul du trait de côte pourn’inclure que le risque d’érosion dans le texte.
Article 68 » Atteintes grave à la pollution des eaux »
Lundi 28 juin 2021, l’article 68 sur les atteintes graves a la pollution a également été voté avec un amendement de la sénatrice Sabine DEXLER qui y ajoute la pollution des eaux (superficielles ou souterraines) dans le champ des atteintes graves et durables. La commission aménagement du territoire du Sénat avait précédemment supprimé le délit d’écocide adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale.
Vote du projet de loi au Sénat le 29 juin 2021 et Commission Mixte Paritaire le 12 juillet 2021
Mardi 29 juin 2021, le Projet de Loi Climat Résilience, a été voté en séance publique au Sénat par 193 voix pour et 100 voix contre. Lundi 12 juillet la commission mixte paritaire à trouver un accord en CMP sur le projet de loi.
Adoption défintive du Projet de loi le 20 juillet 2021
Mardi 20 juillet 2021, le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté définitvement les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Retrouver le texte issu de la Commission Mixte Paritaire
Retrouvez le Projet de Loi Climat Résilience définitvement adopté